If we knew all the laws of Nature, we should need only one fact, or the description of one actual phenomenon, to infer all the particular results of that point.
Henry David Thoreau
Etant arrivé le premier, je minstallai seul sur lherbe au bord de létang, observant tranquillement les ondulations presque imperceptibles de leau, la valse des feuilles dans les arbres et le passage, haut dans le ciel, dun troupeau de nuages. Mon matériel de pêche reposait non loin de moi sur un coin de terre sec : ma tente, mon sac, ma canne, mon épuisette et une boîte de rangement avec, à lintérieur, mes amorces, mes appâts, mes hameçons, mes leurres, mes lignes, mes vers. Javais également une carte des environs, sur laquelle létang dessinait un il grand ouvert au cur des bois et qui donnait différentes indications quant à la profondeur des eaux, la végétation, les poissons ou bien encore les animaux que lon pouvait trouver dans le coin. A quelques mètres devant mes pieds, les araignées deau (Gerris lacustris) faisaient frémir de leurs saccades la surface de létang, tandis quun martin-pêcheur (Alcedo atthis), perché sur un roseau, semblait chercher une proie du regard ; après quelques instants dobservation, je massoupis.
Les poils de leurs pattes sont hydrophobes, cest ce qui leur permet de rester à la surface. Je ne lavais pas entendue arriver, Aline savait se faire discrète. Jai toujours trouvé ça bizarre, les araignées deau. Tu penses que Jésus était hydrophobe, lui aussi ? Un sourire se dessina sur ses lèvres, elle était belle. Je navais jamais connu de fille aussi belle quAline, et lorsque jouvris complètement les yeux, ce fut comme un éblouissement. Elle déposa près de mes affaires son matériel et son panier, dans lequel elle avait préparé de quoi manger pour nous deux jusquau lendemain : deux sandwiches avec salade, tomates et mozzarella, deux Tupperware remplis lun de carottes râpées et de radis, le tout parsemé dun peu de persil, et lautre de pommes de terres grillées coupées en rondelles accompagnées de lardons et de sauce béchamel ; il y avait également des oranges et des pommes et, pour le petit déjeuner, des céréales, des yaourts nature et un paquet de gâteaux au chocolat faits maison. Il était huit heures du matin, cétait le printemps et nous avions tout notre temps. Le ciel était encore légèrement pourpre et les nuages sétaient dispersés pendant ma courte sieste, si bien que la surface céleste était désormais aussi lisse que celle de létang. Aline sallongea près de moi et cest ainsi que la première heure sécoula tranquillement, bercée par le chant lointain des moineaux et des geais, celui, plus proche, des hirondelles et dun balbuzard (Pandion haliaetus), et le coassement sporadique de quelques grenouilles, le tout dans une symphonie palustre dont lharmonie paraissait surnaturelle tant elle était parfaite. De temps à autre nous voyions passer près de nous une aeschne bleue (Aeschna cyanea), une libellule très courante en Europe, me dit Aline à loreille, comme pour ne pas déranger nos visiteuses. Il y avait aussi des demoiselles (Coenagrion puella) et des crapauds.
Nous finîmes par nous décider à installer nos cannes. Je sortis ma boîte de vers, en pris un et le plantai sur lhameçon ; le vers toujours vif, je lançai la ligne au loin dans leau, plantai ma canne dans lherbe et pris ensuite le parti de jeter un peu damorce afin daugmenter mes chances. Aline fit de même puis me proposa daller nous promener le long de létang. Et quest-ce quon fait des cannes ? Aline suggéra de demander au vieux pêcheur qui sétait installé près de nous sil voudrait bien les surveiller et, si un poisson mordait, eh bien, il naurait quà le prendre pour lui-même. Lidée me parut bonne et le pêcheur, Ben, que nous avions rencontré lors de notre première venue dix ans plus tôt, accepta de bon cur en nous souhaitant une bonne ballade. Merci, Ben. La silhouette de Ben sestompa lentement derrière nous tandis que nous empruntions une sente sylvestre qui nous mena tout droit dans une zone jusqualors restée inexplorée par nos pas, en dépit de nos nombreuses excursions des années passées. Territoire inconnu. Nous marchions côte à côte, lair matinal était frais et le sol sous nos pieds était mou ; cétait comme marcher sur des nuages. Au-dessus de nos têtes, les arbres pointaient le ciel du doigt, quelques écureuils voltigeaient en effectuant ici et là quelque cabriole heureuse et bientôt nous fûmes à un bosquet de hêtres. Je mallongeai dans lherbe et Aline se mit tout contre moi. Nous étions heureux.
Quest-ce que cest ? Un poème que jai écrit. Jaime bien. Vraiment ? Pourquoi ? Je ne sais pas, cest comme ça, je crois quil est des choses quon ne sexplique pas et quon ne peut sexpliquer ; cest une bonne chose. Moi je le trouve déprimant. Cest vrai, quil était déprimant, ce poème. Chaque fois que jen disais les vers, ces derniers semblaient marracher tripes et boyaux. Cette fois cétait différent, cependant, comme si les hêtres autour de nous avaient le pouvoir dapaiser toute souffrance, comme si le monde sétait tu quelques instants, juste le temps pour ces quelques maux de tomber dans le silence. Je serrai Aline dans mes bras, blottis ma tête dans son cou puis dans ses seins. La camomille envahit mes narines, les images se mirent à tournoyer dans ma tête. Silence.
Jarrivai à létang à deux heures de laprès-midi, en avance dune demi-heure sur lhoraire prévu. Cétait la première fois que je le voyais, splendide et placide sous un soleil brûlant. Je pouvais lembrasser du regard, mais les reflets membrasaient les yeux ; je massis dans lherbe en attendant quAline arrive, triturant quelques pensées qui avaient probablement jailli du sol au printemps. Javais douze ans et navais pas encore connu ma première éjaculation, ce qui explique peut-être pourquoi je ne ressentais aucune douleur au bas du ventre, ni aucune pulsion onirique trop intense, encore que mon imaginaire fût dores et déjà bien développé, en raison des années de solitude qui avaient précédé. Lattente me parut assez longue malgré tout, et lorsque le froufrou des herbes folles se mêla au chant des oiseaux, ce fut comme un soulagement de voir Aline arriver. Elle sassit près de moi, posa sa tête sur mon épaule ; plus tard, une telle position me ferait suer dès les premiers instants. Il existe dans la vie dun homme plusieurs bouleversements cruciaux, qui le conditionnent de façon irrémédiable pour le restant de ses jours. Tout dabord il y a la naissance, les poumons se déploient, le cordon ombilical est rompu et bientôt les premiers besoins se font sentir : il faut évacuer par tous les orifices, uriner, déféquer, crier. Ensuite il y a lentrée à lécole : quitter le domicile familial ou même celui de la nourrice est toujours une épreuve douloureuse, quon le veuille ou non, et cest la deuxième fois semble-t-il quun cordon est rompu. Lorsque arrive la puberté, lhomme est en général encore assez heureux, mais dès la première éjaculation, les choses se gâtent : le voilà qui entre dans larène, la compétition peut commencer qui déterminera la domination des uns sur les autres et, autant le dire, non seulement ceux qui domineront ne seront pas nombreux, mais en plus le sort réservé à ceux qui perdront nest pas des plus enviables, même si la société dans laquelle nous vivons et interagissons aujourdhui leur offre quelques compensations, comme les films pornographiques, la prostitution ou le mariage, ce dernier étant sur le point de disparaître. Pour tous cependant, cette époque est celle de la première mort ; après, il ne reste plus quà faire le deuil de son enfance et tenter de vivre tant bien que mal selon que les événements qui suivent sont plus ou moins bien subis. Pendant cette période, la pensée pousse comme un champignon sur un sol humide, et avec elle les mécanismes qui régiront les interactions de lindividu avec son environnement ainsi que la façon dont il interprétera le monde réel. Jétais alors sur le point dentrer dans lâge de la puberté, sur le point, donc, de mourir pour la première fois.
Tes parents nont rien dit pour lautre fois ? Non, je crois quils étaient plus gênés que moi. Bon, on va voir un peu comment cest autour ? Pourquoi pas. Aline se leva, prit ma main dans la sienne et fit mine de me tirer cependant que je me levais. Il ny avait pas grand monde à létang, mais petit à petit des grands-pères avec leur petits enfants se déversaient dans les coins peu envahis par la végétation, chargés de tout un bric-à-brac visiblement tout à la fois destiné au pique-nique et à la pêche, en somme tout le nécessaire pour passer une bonne journée en famille. Ce nest que quelques années plus tard que je me rendis compte que lenfance est la seule période de la vie durant laquelle on accepte davoir dans son entourage des vieux. Plus tard, lidée même de vieillesse finit par dégoûter, devient même révoltante, au fond probablement parce que la mort obsède plus que toute autre chose et que lâge, en tant quil est le signe le plus probant que toute matière, et donc également celle dont lhomme se trouve constitué, subit une altération progressive et irrémédiable due au phénomène dentropie et qui dans tous les cas ne peut mener quà un état de désordre supérieur à celui de départ ; en tant que signe de cette dégradation progressive de lorganisme, dis-je, lâge a tôt fait dêtre associé à larrivée inéluctable de la mort. Nous étions très exactement à lopposé de notre point de départ lorsque Aline me demanda quel âge javais. A cet instant quelques images de mes tantes sétonnant de ce que je semblais toujours plus grand (Quest-ce quil a grandi !) et de ma grand-mère me pinçant les joues (Quil est mignon !) défilèrent dans mon cerveau. Aline avait le même âge que moi, elle me donna un baiser près des lèvres. Non loin jentendis un rire gentil ; je tournai la tête, vis un homme assis sur une chaise pliable multicolore. Il devait avoir dans la cinquantaine, portait la barbe et ses yeux pétillaient de vie. Son nez était vraiment très rouge, on aurait dit un clown. Vous gênez pas pour moi, les enfants ! Aline sourit, lui demanda si la pêche était bonne. Oh, ça ne mord pas beaucoup, aujourdhui, mais je men fiche, je ne suis pas là pour ça ! Et vous venez souvent ici, monsieur ? Oui, tous les jours, chaque année, dès les premières semaines de printemps. Mais ne mappelez donc pas Monsieur, mon nom cest Ben. Appelez-moi Ben. Daccord Ben. Hé, les enfants, vous voulez que je vous montre un truc ? A lépoque, on voyait tous les jours des histoires denfants abusés sexuellement aux informations, je crois que la première chose qui me traversa lesprit lorsque Ben eut terminé sa phrase fut une bite flasque et ridée tentant de se faire un chemin dans ma bouche. Aline me prit par la main et je la suivis sans réticence réelle. Jétais même assez curieux.
La journée était sur le point de se terminer, le soleil perdait peu à peu ses couleurs pour senfoncer dans la nuit et le sol jonché de feuilles brunes prenait la couleur de létang. Assis sur deux chaises pliantes placées lune à côté de lautre, Aline et moi contemplions les ondulations imperceptibles de la surface en silence, cependant que des bois environnants commençait démerger la solitude sourde des nuits dautomne. Il y avait un peu de vent, tout juste de quoi rafraîchir lair déjà froid qui nous asséchait les poumons et la peau, malgré nos couvertures. Nous avions seize ans et la vie devant nous, jétais en première littéraire, Aline en première scientifique, et déjà le champ des possibles sétait quelque peu resserré ; mais nous avions la vie devant nous. Tu veux faire quoi, plus tard ? Je ne sais pas, dessinateur de B.D., écrivain, réalisateur, jaimerais bien créer des trucs. Et toi ? Je veux comprendre le monde. Ca, cest de lambition ! Pas vraiment, cest juste banal, mais ça mobsède. Tu crois en Dieu ? Je ne crois rien. Tu crois quil ny a rien derrière tout ça ? Lunivers, la vie, lhomme ? Je te lai dit, je ne crois rien. Disons simplement que si dieu il y a, sous quelque forme que ce soit, son utilité me paraît douteuse et son action sur lunivers, bien limitée. Il ny a pas de miracle, ni de chance ou de malchance. Il y a seulement une logique densemble qui nous échappe parce que nos perceptions nous font défaut ; cest cette logique, qui mintéresse. Donc, tu crois que tout obéit à des lois On peut dire ça, mais ce nest quune possibilité parmi dautres ; après tout lunivers pourrait bien être totalement incohérent ou obéir à différentes lois selon les zones, ça ne changerait pas grand-chose au fait que le tout fonctionne. Et comment a-t-il commencé, selon toi ? Mauvaise question : il na selon toute logique jamais commencé et ne pourra jamais prendre fin, le paradoxe étant quil forme malgré tout quelque chose duni, mais peut-être est-ce là seulement son nom qui nous induit en erreur. Je vois mieux comment Dieu devient inutile pour toi. Avec une théorie pareille, plus besoin de création ! Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, disait Lavoisier. Quand on meurt, on ne va nulle part, il ny a ni paradis ni enfer, seulement de la matière qui change détat. Dans ce cas, quest-ce quon fait là, puisque nos vies nont pas de sens ? Tu sais, il y a encore des peuples sur Terre qui croient que tout autour deux est animé, possède une âme propre. Quest-ce que tu veux dire ? Eh bien, simplement ce que je veux dire, que lhomme voit du sens partout alors quil nest quen lui-même. Sa présomption pourrait le conduire jusquà penser que, sans lui pour le regarder, le monde nexisterait pas. Or, quand un homme meurt, le monde ne disparaît pas avec lui, et lhumanité toute entière pourrait disparaître que cela ne ferait aucune différence. Pas faux, mais ce nest tout de même pas très rassurant, tout ça.
Le soleil disparu, seul le ciel gardait la trace incandescente de son passage récent, et les arbres effeuillés dessinaient sur le crépuscule naissant détranges squelettes. Le vent portait à mes narines une douce odeur de camomille, tandis que je sentais sur moi le tendre regard dAline ; et bientôt je sentis rouler le long de mon épine dorsale une larme de sueur glaciale qui sembla sarrêter à mi-chemin. Je nosais pas tourner les yeux, mon rythme cardiaque saccéléra, ma respiration devint hésitante. A seize ans, lhomme est sous lemprise de ses hormones, cest un fait, mais cest toujours plus facile à dire quà vivre, cette période se caractérisant par une augmentation considérable de la fréquence des masturbations et laccumulation progressive dune forme de frustration sexuelle qui généralement ne trouve aucun exutoire, sinon les films pornographiques et le viol, individuel ou groupé. Cest également lâge auquel on tombe amoureux, pour les mêmes raisons, et certains ne sortent jamais de cette maladie (on tombe amoureux comme on tombe malade, dans tous les cas on tombe) car nayant pas compris quil sagit là dune combinaison complexe de facteurs chimiques, physiques, physiologiques, psychologiques et idéologiques, qui conduisent dans tous les cas à la douleur et à la souffrance et dont il est difficile de se distancer, parce que cet amour est assouvi pour les uns, parce quil ne lest jamais pour les autres, et pour dautres encore parce quils nont pas le courage de mettre en doute les fondements de leur pensée. En somme, cest par choix plus ou moins volontaire que nous restons toute notre vie prisonniers de nos chimères. Schopenhauer avait raison, le libre arbitre, cest de la connerie. Ca ne va pas ? Si, si, je suis un peu nerveux, cest tout. Je ne métais pas rendu compte que depuis quelques minutes, la main dAline caressait mon avant-bras sous la couverture. Cest un peu comme ne sentir la guêpe sur sa peau quau moment de la piqûre. Aline ny était pour rien, jétais trop inhibé pour mavouer lamour que jéprouvais pour elle, sans parler de le lui avouer, à elle. Elle appuya sa tête contre mon épaule, ne dit rien. Silence.
Il faisait nuit, cétait lhiver. La surface nétait plus quun bloc de glace opaque. Il faisait froid, mais la température demeurait raisonnable, probablement en raison du réchauffement climatique. Enfin toutes ces conneries, je men foutais un peu. Aline était partie, jétais seul. Pas une étoile dans le ciel, seulement la lune, blafarde et comme préoccupée. Cétait la fin du premier semestre et je venais de recevoir les résultats de mes examens : excellents. Mes parents seraient heureux, iraient raconter ça à tous leurs amis et menverraient probablement un cadeau par la poste. Peut-être un film. Je somnolais, des images défilaient dans le ciel sur le noir écran de linfini, autant dhallucinations oniriques qui me rappelaient Aline et ces moments de bonheur qui jamais ne reviendraient. Je nous revis jouant à la console toute la nuit, découvrant la carpe titanesque de Ben, discutant les théories de la relativité générale et des quanta, conjecturant la fin du monde et limpossibilité de lexistence dune divinité quelconque, imaginant lunivers telle une sphère, sans début ni fin et pourtant bel et bien finie, nous tenant la main pendant que nous errions par-delà les sentiers sylvestres et explorions des territoires inconnus, broussailleux et infestés dinsectes aux formes étranges, nous enlaçant tendrement dans lherbe tout humide de rosée, échangeant un bref baiser la veille de
Javais mal aux yeux, un picotement me démangeait lépiderme et bientôt jeus le regard si embué quil ne métait plus possible de discerner le moindre objet de façon nette. Peut-être mendormis-je quelques instants. Tout était flou, je ne distinguais plus que des ombres et bientôt un vent glacial me brûla la peau tandis quau loin, sur la surface de létang, une silhouette apparaissait, presque lumineuse au beau milieu des ténèbres, faisait scintiller la glace de mille étoiles impossibles et tournait lentement son regard dans ma direction. Cétait Lina. Dun geste de la main elle mindiqua de la suivre, puis séloigna dun pas serein, presque aérien. Comme hypnotisé, je ne pus résister à la tentation de me lever et de la rejoindre. Je ne sentais pas le sol sous mes pieds, pourtant jentendis bientôt létang craquer sous mon poids, et lorsque je fus à sa hauteur, le cur battant la chamade et mon dos ruisselant de sueur, je la pris dans mes bras et nous dansâmes, dansâmes jusquà ce que sous nos pas la surface se brisât.
Alors, ta Lina, tu las pas encore trouvée ? Rachid avait pris sa journée pour maccompagner au supermarché, nous avions de nombreux achats à faire et les filles comptaient sur nous pour préparer un réveillon digne de ce nom. Aussi surprenant que cela puisse paraître, nul parmi nous ne considérait cet événement comme un événement. Cétait juste un jour comme un autre, auquel on avait assigné la fonction particulière de repère temporel, la notion de cycle étant fondamentale dans le fonctionnement de toute société humaine nous avons en effet besoin non seulement de représenter dans nos rites la pérennité de la vie et léternel retour du même au sein de la nature, mais aussi de nous rassurer en prévoyant par le moyen du calendrier le moment exact de ce retour ; nous navons pas tellement changé, depuis lépoque où le soleil pouvait disparaître du jour au lendemain sans laisser de trace. Non. Jinsérai une pièce et dégageai le chariot de son étreinte dacier.
Averties par le détecteur de mouvement, les portes coulissantes souvrirent pour nous laisser pénétrer dans le dernier temple moderne, dédié tout entier à la déesse du nombre, de la propriété et du désir. Une rangée sans fin de caissières, accomplissant sagement leur tâche mécanique sans sourciller, sétendait telle une frontière devant les rayons elles se ressemblaient toutes, dans leur uniforme rouge et blanc, avec leur prénom sur un badge rectangulaire en plastique (Sandrine, Blandine, Géraldine, Elodie, Mélanie, Elodie), et les rayons aussi, se ressemblaient, avec leurs successions ininterrompues de boîtes de céréales, des pétales de maïs au blé soufflé en passant par les nouvelles variétés au quinoa, à la pâte à tartiner ou bien encore au caramel ; de boîtes de conserve, haricots verts ou blancs, lentilles, petits pois, cassoulet ou sardine, tranches dananas, salades de fruits, tomates ou maquereaux ; de produits ménagers, de leau de Javel au détartrant, en passant par la lessive, le dégraissant et le liquide vaisselle, jaune, rouge ou vert. Dans ce temple on saccroupit pour accéder aux prix les plus bas, ou bien on se met sur la pointe des pieds, espérant atteindre du bout des doigts la dernière bouteille deau dEvian, on pousse son chariot doffrandes le long des allées dans un tintamarre infernal, le siège pour bébé cognant à chaque rebond des roues sur les interstices du sol carrelé contre la grille métallique et, de temps à autre, on se retrouve coincé, les roues refusant de se mettre daccord pour aller toutes ensemble dans la même direction ; quoi quil arrive, si ce ne sont pas les roues, ce sont les autres clients qui errent en tous sens et se bousculent les uns les autres sans même sembler se rendre compte de leur présence respective. De loin, on pourrait sûrement croire en observant un tel spectacle quil sagit dun mécanisme dont les rouages se sont désunis petit à petit pour ne plus laisser quune vague sensation de mouvement discontinu, susceptible un jour de sarrêter brutalement. Ici une mère gifle son enfant, là un père traîne son fils, qui ne veut pas quitter le rayon jouets. Ici une petite fille perd de vue ses parents, là un gardien saisit une cleptomane par le bras. Ici deux chariots se croisent et se coincent (on a récemment fait diminué lespacement entre les rayons pour en mettre plus, doù une exiguïté très incommodante), là quelques bouteilles de bière tombent et se brisent ; une odeur amère se répand sur quelques mètres, quelques clients se réveillent soudain de leur torpeur pour afficher quelques secondes un air stupéfié sur leur visage (les yeux sortent de leurs orbites, la bouche sentrouvre, un rictus dagacement ou dincrédulité se dessine au coin des lèvres et parfois une remarque surgit du néant pour y retourner aussitôt ils pourraient faire attention, un peu !). Ils ressemblent vaguement aux spécimens congelés du rayon poissonnerie. Fais gaffe ! Une petite fille sétait mise en travers de mon chemin, elle se mit à pleurer, je lui avais roulé sur les pieds. Allons, allons, ça va aller, ma petite, ce nest rien. La mère, sur le point de franchir la limite entre embonpoint et obésité, courut à son enfant, se dressa tel un pilier face à moi, me fusilla du regard sans mot dire et prit enfin sa progéniture dans ses bras pour la placer dans son chariot. Je tavais bien dit de ne pas técarter, ça tapprendra. Rachid éclata de rire : les parents semblaient ce jour-là sêtre donné le mot pour mettre leurs enfants dans les caddies, et les enfants, pour en sortir. On aurait dit des singes en cage.
Nous arrivâmes chez Aline aux alentours de dix-neuf heures, les bras chargés. Jappuyai longuement sur linterrupteur, ainsi quAline me lavait recommandé lors de ma première visite, puis sa voix retentit, métallique. Cest ouvert. Un bourdonnement sonore se fit entendre quelques secondes, le temps pour moi douvrir la porte, et se tut lorsque Rachid fut à lintérieur. Lascenseur étant bien trop étroit pour nous deux, nous décidâmes demprunter les escaliers ; trois étages, ce nétait pas grand-chose. En haut, Aline et Li nous attendaient, la porte était grande ouverte derrière elles et une odeur dencens avait envahi létage qui nétait pas désagréable. De lappartement den face se pouvaient distinctement entendre les cris dun couple ; je compris quelques paroles éparses, mais la raison de la dispute méchappa quelle quelle fût, aucun des deux partis nen acceptait la responsabilité, rejetant la faute sur lautre avec rage et empressement (des flots de mots se déversaient de temps à autre en un vomi torrentiel), comme sil sétait agi dun charbon ardent. Un enfant pleura. Laisse-moi taider. Aline me libéra du sac de bouteilles, posa quelques secondes son regard sur moi, un regard doux, paisible et heureux, dans lequel je décelai cependant une étrange lueur, presque contradictoire. Rachid et Li se précipitèrent dans la cuisine afin dy déballer les provisions, tandis quAline et moi nous rendîmes calmement au salon, posâmes les bouteilles et les gâteaux apéritifs sur la table basse et nous installâmes sur le canapé, trop heureux que nous étions de nous retrouver pour prendre le temps de déballer les sacs. Elle se blottit contre moi, je la serrai dans mes bras. Je posai mes lèvres dans ces cheveux, inhalai profondément le délicieux parfum de camomille tout en fermant les yeux. Tu mas manqué. Toi aussi. Jai beaucoup de choses à te dire. Beaucoup de choses. Lorsque je rouvris les yeux, je nous aperçus dans lécran de télévision, qui était éteint. Cétait une belle image, bien quassombrie par le noir de lécran.
Bon, quest-ce quon prend, pour ce soir ? Aline naime pas le vin, cest ça ? Si, si, mais seulement le blanc. Et on prend quoi dautre, comme alcool ? Un peu de whisky, de la Manzanita, du Malibu Coco et de la vodka, ça devrait suffire. Je men charge. Rachid me laissa seul, il me restait à choisir ce quon servirait en apéritif, et le choix était plus que vaste : cacahuètes salées ou grillées, pistaches, noix de cajou, diverses variétés de chips, petits fours au goût de pizza ou de fromage, tacos, petits gâteaux aux formes variées, allant du cylindre à la pyramide, en passant par les fantômes et les frittes. Un point commun cependant : tout était excessivement gras. Je saisis, non sans quelque dégoût anticipatif, quelques sachets ici et là, que jentassai sans grande conviction dans le chariot, déjà bien rempli. Pardon. Le mot me caressa les oreilles avec volupté. Ce nétait pas Rachid, ni une mère à lembonpoint certain, ni même encore une enfant qui aurait perdu ses parents dans cet immense dédale quétait toute grande surface pour toute personne dont lâge nexcédait pas les douze ans il semble cependant que, plus âgés, nous continuions inlassablement à nous perdre en surface non, cette voix féminine et charmante était celle dune jeune fille aux longs cheveux blonds et ondulés, dont le regard orné de deux perles turquoise croisa le mien lespace dune éternité pour ne plus jamais me quitter, une fille tout droit sortie dun conte de fées. Pardon. Dans ma stupeur, jétais resté immobile, incapable du moindre mouvement, la bouche entrouverte. Je me décalai légèrement pour lui laisser attraper un paquet de biscuits croustillants sur le rayon le plus bas. Se relevant et jetant un rapide coup dil à mon chariot, elle me remercia et sourit : vous préparez une soirée ? Euh, oui, oui. On ne sest pas déjà vus ? Non, je ne crois pas, je pense que je men rappellerais On ne rencontre pas tous les jours une fille aussi charmante. Les mots étaient sortis deux-mêmes, presque malgré moi. Si, si, je suis sûre quon se connaît. Peut-être à luniversité, dans ce cas ? Oui, cest ça ! On est dans le même amphithéâtre, en cours de civilisation britannique. Ah, oui, cest bien possible. Cest bizarre, il ne me semble pourtant pas vous avoir jamais vue. A dire vrai, je me mets toujours au fond, mais je tai remarqué depuis un moment, tout seul devant on peut se tutoyer, hein ? Oui, oui, bien sûr. Au fait, moi cest. Je sais comment tu tappelles, fit-elle, un sourire plus large encore sur ses petites lèvres roses. Moi, cest Lina. Je ressentis comme un choc, mes yeux durent sécarquiller, comme pour laisser mon cerveau sécouler par leurs orbites. L-Lina ? Lina Rainheart ? Presque ! Lina Renart, comme le roman. Pardon ?
Dans la cuisine un fracas retentit : un verre sétait brisé. Fais gaffe, nom de Moi ! Li sortit pour sexcuser auprès dAline, qui ne lui en tint pas rigueur, puis retourna aider Rachid à préparer le repas, dont tous deux nous avaient promis quil serait exquis. Je venais de conter ma rencontre de laprès-midi, non sans un certain enthousiasme, à Aline, qui était demeurée muette depuis. Et quelles sont ces choses que tu voulais me dire ? Son regard sembla sassombrir, ses yeux devinrent deux puits de ténèbres insondables. Mes recherches ont enfin abouti, mais je ne suis pas sûre quil faille que je ten fasse part, du moins pas aujourdhui, pas maintenant. Tu en as déjà trop dit. Oui, mais ta rencontre daujourdhui ne fait que confirmer ce dont je nétais pas encore tout à fait certaine. Je ne vois pas le rapport. Peu importe, tout ce quil faut que tu saches, cest que ce nétait pas un hasard, tout comme ce nest pas un hasard si nous avons cette conversation. Que ce ne soit pas un hasard, ça na rien de gênant : une chose en entraîne une autre. Ce nest pas de ça que je te parle, ce nest pas une question de causalité. Il va de soi que tout en ce monde est tout à la fois cause et conséquence, que ce qui ne semble à première vue régi que par les lois de laléa le plus incompréhensible qui soit, nest en fait que le résultat dune logique située à une échelle bien trop grande pour que lhomme, trompé par ses sens ainsi que par sa vision limitée des événements, puisse un jour espérer lappréhender dans sa totalité, et si nous cherchons par exemple depuis quelques années à unifier les théories quantique et de la relativité, et sil est également probable que tôt ou tard nous y parvenions, il se trouvera néanmoins toujours devant nous une nouvelle énigme pour nous replonger dans cet océan dincertitude et de ténèbres dans lequel nous baignons depuis les premiers pas de lhumanité et qui ne cesse de sagrandir à mesure que nous avançons. Ce que jai découvert ne contredit en rien cet état de fait, en revanche il se pourrait que cela remette fondamentalement en question la réalité de notre existence. Peut-être serait-il dailleurs plus judicieux de parler dinsistence. Je ne vois toujours pas où tu veux en venir : tu veux dire que nous nexistons pas ? Oui et non. Disons plutôt quil se pourrait que nous ne soyons pas ce que nous pensons être. Pour moi, un rêve sest brisé.
On se reverra. Lina Renart me souhaita de passer un bon réveillon, puis disparut derrière un rayon. Je ne devais jamais la revoir.
Je suis toujours dans son bureau. A ma gauche sélève la vidéothèque, à ma droite la bibliothèque, en face la ludothèque et derrière la discothèque. Il est assis à son bureau, moi sur une chaise métallique toujours aussi confortable. Je crains quil mécrive.
Rachid et Li échangèrent un regard tendre. Le repas était prêt. Aline et moi nous assîmes en face lun de lautre, cependant que Rachid déposait les gâteaux apéritifs sur la table. Les verres se remplirent dalcool, les rires coulèrent à flots, lentrée puis le plat de résistance furent bien vite engloutis et la conversation nous emporta loin sur les rives de la politique, du nazisme, de nos activités respectives et du futur changement de prénom de Rachid, qui envisageait de se faire appeler Richard, et bientôt limpétuosité de certaines remarques ou plaisanteries de mauvais goût fut noyée sous le poids de la fatigue et de nos ventres par trop gonflés. Quelques mois plus tard, comme pour se conformer à cet adage selon lequel un malheur n'arrive jamais seul, Rachid mourait lors d'une intervention de police dans un quartier chaud de Domuse, la gorge tranchée par un noir. Il y eut une cérémonie officielle, un étendard français sur son cercueil, et sur sa tombe on grava quelques malheureuses lettres : Richard Benbraki. Mort en service. Li pleura beaucoup, repartit en Chine quelques semaines après, je ne devais plus jamais entendre parler d'elle, comme si elle n'avait jamais existé. Il y eut également quelques lignes dans un journal local, évidemment son nom dans la rubrique nécrologique, et l'on fit peu de cas de son décès dans les bulletins d'information télévisés, comme il était de coutume avec les policiers. On peut dire que Rachid avait fini par s'intégrer complètement. Alors comme ça tu veux changer de prénom ? Oui, j'en ai marre qu'on me prenne pour un Arabe, je suis français, j'ai vécu toute ma vie dans ce pays, ma culture c'est la France, rien d'autre, peu importe mes origines. Li resta silencieuse, le sujet semblait la dépasser ; Aline, quant à elle, baissa les yeux, peut-être perplexe, peut-être parce qu'elle avait autre chose en tête. Je la regardais, impuissant, incapable de comprendre ce qui la préoccupait, ce qu'elle avait plus tôt cherché à me dire.
Aline et moi avions déjà dix-huit ans, lorsque pour la première fois nous passâmes la soirée du réveillon ensemble. Ses parents nous avaient laissé leur maison, une grande et belle ferme rénovée qui s'élevait au milieu d'un terrain gigantesque et rarement tondu, si bien que subsistait toujours la crainte, lorsque nous nous y aventurions, de nous faire mordre par quelque vipère sournoise, ou bien encore de nous faire attaquer par une bête quelconque. Vestige de temps oubliés, se trouvait au fond du jardin (une petite partie du terrain avait malgré tout fait l'objet d'un soin particulier dans le cadre d'un aménagement esthétique, soit quelques fleurs éparses accompagnées d'arbustes maigrelets et de buissons rectangulaires) une petite cabane en bois : les toilettes. C'était, depuis que j'étais venu pour la première fois en ces lieux, un objet de fascination, et je m'imaginais chaque fois courant de la demeure à cette ruine exiguë pendant l'hiver, de bon matin, la vessie pleine et les doigts gelés. Aline me raconta ce soir-là comment, une année que les canalisations entartrées étaient demeurées inutilisables, elle avait dû, chaque jour, se rendre en cet endroit infâme et lugubre (bien que d'une petitesse sans égale, cette pièce sans éclairage avait en effet quelque chose de sinistre, tant dans son délabrement que dans son isolement), parka sur le dos et papier hygiénique à la main. Allez, entre. Aline avait elle-même préparé le repas, des huîtres et autres fruits de mer, le genre d'aliments qui habituellement me donnaient la nausée mais que l'occasion m'avait rendus délectables. Mon amie m'entretint de sa dernière découverte, A Brief History of Time, qui semblait la fasciner plus encore que celle, quelque temps auparavant, d'un obscur ouvrage d'entomologie. Elle m'en lut quelques passages, et c'est ce jour-là que je compris son engouement pour les sciences : c'était en effet là que se posaient désormais les grandes questions métaphysiques de notre temps, et si des philosophes avaient pu avoir autrefois quelque intuition remarquable de temps à autre, ici et là, il n'y avait pas de doute quant à la capacité de la science à apporter des réponses précises, justes et vraies, à des interrogations séculaires. Et surtout, à poser les bonnes questions.
Rachid et Li s'étaient endormis sur le canapé, dans les bras l'un de l'autre ; ils avaient sur le visage un air serein, encore que les sourcils de Rachid fussent légèrement froncés. Aline et moi étions maintenant sur le balcon, assis sur un banc de plastique, incongruité discrète à l'ombre des lumières orangées de Domuse, dont les immeubles s'élevaient comme des stèles vers le noir océan de l'infini. Aline se blottit contre moi, enfonça sa tête dans le creux de mon épaule, posa sa main sur mon torse ; sur ma peau je pouvais sentir son souffle chaud me caresser, tandis que son parfum m'enivrait peu à peu. Je passai ma main autour d'elle, comme pour la protéger. Au fond, c'est peut-être ça, l'amour. Non pas l'attirance physique, le coup de foudre, la sensualité des corps qui fondent et se confondent pour ne plus faire qu'un, ni même encore cette âpre frustration qui saisit le jeune adolescent amoureux, fou de passion pour cette jeune fille qui le méprise au mieux, qu'il indiffère au pire, et dont il sait bien qu'il ne pourra jamais être que l'ami, et non l'amant, mais bien plutôt ce sentiment qui naît de liens profonds, renforcés par les années, et qu'une proximité dans la pensée ainsi que dans l'action vient enfin sceller, un amour sain, en somme, un amour qui n'est ni vorace, ni létal, qui ne s'affadit ni ne s'étouffe après une rencontre orageuse, mais qui s'inscrit dans la durée, la connaissance et la reconnaissance mutuelles, se prolonge jusques aux tréfonds de nos organes pour y prendre racines et finit par nous sembler aller de soi, si bien que l'être aimé devient chair, devient sang, le parfait complément, cette moitié originelle finalement retrouvée et dont on ne saurait se séparer, sinon par la mort. Sans vraiment m'en rendre compte, comme inconsciemment, je laissai ma main glisser lentement sur son bras, le caresser tendrement, puis poursuivre sa route le long de ses courbes délicates, plonger dans la laine du pull dont elle s'était couverte, puis nos visages finirent par se rencontrer, se frôler, se frotter avec fébrilité, et nos lèvres enfin, s'effleurant tout d'abord, échangèrent un doux baiser. Il n'y eut pas de sudation, ni de tachycardie, je me sentais bien, vraiment très bien.
Face à nous, en dessous et au loin, obstruant l'horizon, le cimetière urbain expirait tranquillement son râle, entre pots d'échappement et vociférations grotesques de passants ivres de désespoir et d'alcool, aboiements de chiens égarés et portières claquées, malades à l'agonie et musiques de boîtes de nuit, une cacophonie funèbre que venait soutenir le chant des sirènes, cependant que sous l'effet Doppler elles s'envolaient vers des mondes étrangers, comme pour y noyer les habitants de la vile. Tu sais, ce que je te disais, tout à l'heure, au sujet de notre existence ? Aline venait d'adopter un ton d'une gravité terrifiante, un ton que je ne lui connaissais pas. Oui, tu disais que tu avais découvert quelque chose qui pouvait chambouler tout ce qu'on sait, ou un truc dans le genre. Exactement. Eh bien, c'est quoi, cette découverte ? Je ne sais par où commencer, mais puisqu'il le faut... Disons que je me suis toujours opposée à toute forme de téléologie, que je n'ai jamais cru ni aux origines, ni à la fin du monde, ni en quelque autre ineptie du même acabit, que la seule vérité qui s'est toujours imposée à moi est celle d'une évolution constante, d'un changement perpétuel, peut-être un éternel présent, de sorte que l'idée de dieu, d'être créateur, et donc la notion même que l'univers puisse avoir un sens, celui-là même en lequel tout ne cesse de tourner en rond et au sein duquel rien ne semble pourtant tourner rond, cette idée devient totalement absurde, dénuée, justement, de sens. Mais voilà : depuis quelque temps, je rassemble des éléments troublants, des faits que je ne relevais auparavant qu'occasionnellement, c'est-à-dire au hasard de mes pérégrinations intellectuelles, lorsqu'il me venait à l'esprit l'évidence des implications de tel ou tel événement dans la possibilité qu'il y ait, disons, un ailleurs. Mais ça ne m'intéressait pas plus que ça, tout au plus cela provoquait-il un léger trouble en moi, le sentiment que, dans ma conception du monde, quelque chose ne collait pas. Aujourd'hui, j'ai peut-être la preuve de cet ailleurs, mais il se peut que tu croies que j'ai perdu la raison, une fois que je t'aurai fait part de ce que je sais. Aline commençait en effet à m'inquiéter, mais je ne répondis rien, me contentant d'esquisser un hmmm dubitatif. Prenons par exemple ta chimère, Lina : tu ne trouves pas bizarre de l'avoir rencontrée en chair et en os ? Je ne l'ai pas vraiment rencontrée, elle lui ressemblait, certes, et portait presque le même nom de famille, mais ce n'est qu'une coïncidence, je ne vois pas où tu veux en venir. D'accord, alors dis-moi comment tu t'appelles. Pardon ? Oui, dis-le moi. Pourquoi je ferais ça ? Tu sais très bien comment je m'appelle. Allez. Non. Tu vois, tu ne peux pas, et moi non plus, je ne sais pour quelle raison, mais c'est ainsi, un peu comme dans ce film avec Arnold Schwarzenegger, Last Action Hero, quand il s'aperçoit qu'il ne peut pas dire de grossièretés. Ha ha ha ! Tu penses qu'on est dans un film, c'est ça ? Je l'avais bien dit : tu me prends pour une folle, maintenant. T'es vraiment sérieuse ? Eh bien... Ca fait un peu Matrix, ton histoire, bientôt tu vas me proposer de prendre une pilule colorée ! Voilà, tu te moques de moi. Non, c'est juste que, si, philosophiquement, ça se tient, car après tout il n'y a pas de raison pour qu'on ne soit pas les héros d'une fiction, ça reste malgré tout complètement absurde ; et si je devais voir ça dans un film, ou le lire dans un roman, je trouverais ça un peu surfait, et je me dirais, au moment de la fin, du probable twist ending : « Tout ça pour ça ? ». Tu trouves que ça ne tient pas debout, alors ? Franchement, non. Et puis, si on est dans un livre, il ne peut s'agir que de sous-littérature, et je plains l'auteur de n'être pas capable de faire mieux, vraiment. Au mieux dira-t-on qu'il s'agit de métafiction, et encore.
Long silence.
Aline finit par admettre qu'il ne s'était agi là que d'une intuition, que seule la mort permettrait d'avérer ses dires. Il était tard, les lumières de la ville peu à peu s'éclipsaient, plongeant les grands blocs de béton dans la pénombre des lampadaires, cependant que la nuit s'intensifiait, vide et béante, emportant avec elle tout espoir et tout regret, avec pour seul cortège quelques étoiles esseulées. Aline s'endormit dans mes bras, je la serrai contre moi, comme pour la protéger du froid.
Que l'univers, nos actions, nos vies, nos amours, nos rancoeurs, nos haines, nos passions, que tout enfin dans ce monde ait ou non un sens, je ne suis malheureusement pas en mesure de te le révéler : je me pose les mêmes questions, suis sujet aux mêmes doutes. Lorsque j'ai tué Aline, sa mort avait un sens, tout comme la plupart des événements de ce roman. Lorsque je t'ai fait travailler dans une vidéothèque, ou bien rencontrer Lina Renart, ou encore raconter tes histoires d'adolescent mal dans sa peau, c'était, bien sûr, un choix délibéré, réfléchi, encore que par moments il ait été possible que je me sois laissé emporter par le flot de mes phrases, noyé dans mes pensées les plus obscures, souterraines et qui ne sont remontées à la surface que sous forme d'images assez vagues, d'allusions douteuses à un passé déjà flou, de mots, enfin, dont j'ai perdu le sens. Fruit de nombreuses nuits d'insomnies, de folies passagères, d'un besoin constant de placer des mots les uns à la suite des autres, d'exprimer le mal à dire, ce roman comporte, tout comme moi, de nombreuses imperfections, mais toujours il s'est soumis à ma volonté, mes exigences, sans jamais se plaindre. En revanche, ce qu'il adviendra de lui, et de moi, par la suite, ça, je ne saurais le dire : lorsque j'aurai mis un point final à ce monstre, il fera ce qu'il voudra, au gré des lectures ; je ne serai pas là pour le voir. Tu te demandes sûrement ce que tu fais là, dans cette pièce, sur cette chaise métallique ; à ce propos je n'ai qu'une chose à te dire : tu es sur le point de mourir, et donc de renaître. Ces paroles te semblent obscures, je le vois, mais tu comprendras bien vite.
Pour répondre à la question que tu te poses depuis quelque temps, Aline avait raison, et l'ailleurs, c'est moi. Malheureusement, cela ne veut pas pour autant dire qu'il y ait également pour moi-même un ailleurs, ce qui signifie que, si le roman comporte quelque sens interne, il en va tout autrement de son existence, qui reste, elle, sans explication. Ou plutôt si : je l'ai écrit. Pourquoi, ça... Et pourquoi moi, d'ailleurs ? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse, et finalement c'est peut-être la raison pour laquelle je t'écris, je m'écrie. Enfin, ça, ce serait plutôt le sujet d'une autobiographie, et il est peut-être temps de mettre un terme à ce récit, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Non, bien sûr, que tu ne m'en voudras pas, du moins pas si je décide que non. Et oui, je décide que non.
Derrière lui, un miroir me regarde, posé sur une étagère : c'est étrange, on dirait qu'il se trouve quelqu'un, penché par-dessus mon épaule, qui lit.
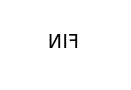
Je tiens à remercier Julien L., Damien L.B., Laure G., Elodie L., Anne-Laure S., Pearl D., et tous les individus, proches ou non, connus ou inconnus, sans qui Lina n'aurait jamais vu le jour.
Ecrit entre 2007 et 2008. Erwan Bracchi.
Werna 2009-2023