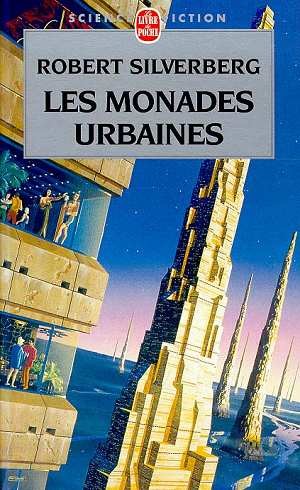 Année : 1971
Année : 1971
Titre original : The World Inside
Auteur : Robert Silverberg
En l'an de grâce 2381, 75 milliards d'êtres humains vivent, semble-t-il, en harmonie dans ce que l'on appelle les monades urbaines : d'immenses
tours hautes de trois mille mètres et constituées en tout et pour tout de mille étages chacune, ces étages formant à leur tour, par groupe de quarante environ,
des cités aux noms pour le moins éloquents (Louisville, Chicago, Paris, Tolède, Reykjavik, Shanghaï, Prague), dans lesquelles sont regroupés les habitants (885 000
en moyenne par tour) en fonction
de leur classe sociale - plus on s'élève haut dans les airs, plus on monte haut sur l'échelle hiérarchique. A l'intérieur, on se marie jeune,
et chacun, par le truchement des visites nocturnes, est libre d'aller où bon lui semble afin de forniquer avec des femmes et des hommes - eux aussi mariés -
de son choix, le but étant avant tout de se reproduire, de procréer un maximum afin de faire prospérer la race humaine et de prouver à Dieu
le respect que l'on a de sa création. Quiconque se refuse à respecter les lois et la joie de la monade est considéré comme anomo - quiconque est
considéré comme tel connaîtra la mort dans la chute et le recyclage de ses chairs. La monade 116 est l'une de ces magnifiques
et majestueuses tours, qui fait partie des cinquante et une monades de la constellation dite des Chipitts (qui s'étend de l'endroit où se situait autrefois
Pittsburgh à l'ancienne Chicago). A l'intérieur, les existences contrastées de Dillon Chrimes, joueur de vibrastar dans un groupe cosmique, des
tout jeunes Aurea et Memnon Holston, qui craignent d'être envoyés, faute d'enfants, dans une autre monade, de Mamelon Kluver et de son
mari Siegmund Kluver, appelé à faire un jour parti de l'élite monadiale, de Charles Mattern, un socio-computeur, de Jason Quevedo, historien spécialiste
du XXe siècle et de ses moeurs incompréhensibles, de Micaela Quevedo et de son frère jumeau Micael Statler, un analo-électronicien qui
rêve de sortir un jour de la monade afin de visiter le monde et de découvrir les villages agricoles - les existences de ces personnages
hauts en couleurs, disions-nous, se croisent et s'entrecroisent, se mêlent et s'entremêlent, pour nous livrer une vision somme toute
critique de la monade,
de ses moeurs et des sentiments divers que l'on y peut éprouver. La surface transparente
de la monade, monotones et carcérale dans sa sublime verticalité,
finit doucement par se fissurer, laissant apparaître, sous le vernis d'un système en apparence parfait - c'est-à-dire parfaitement
adapté à une situation donnée -, sous la fiction de sa philosophie fonctionnelle,
la souffrance sourde et solitaire des personnes qui la peuplent et la repeuplent.
Comme on peut aisément le constater à la lecture des lignes qui précèdent, Les Monades urbaines,
oeuvre qui n'est autre en réalité qu'un recueil de sept nouvelles de longueur à peu près égale,
se propose de plonger son lecteur au coeur d'une dystopie digne du 1984 de George Orwell et
du Meilleur des mondes d'Aldous Huxley, tout en se posant la question caractéristique de la plupart des
écrits d'anticipation à ce jour : "Et si... ?" A l'époque où Robert Silverberg l'écrit, se pose, comme
en témoigne le film Soleil vert (1973) de Richard Fleischer, la question récurrente
de la surpopulation : pour les
défenseurs et partisans du malthusianisme (une doctrine héritée des théories de l'économiste Thomas Malthus (1766 - 1834), qui pensait
que l'accroissement constant de la population mondiale deviendrait un jour un problème en raison de l'insuffisance, à plus ou moins long terme,
des ressources terrestres),
l'une des seules méthodes efficaces pour éviter le surpeuplement de la Terre se situait dans la réduction volontaire de la natalité - la létalité n'étant,
elle, plus considérée comme un problème, ce que semblent, au passage, avoir très bien compris les dirigeants chinois.
L'oeuvre de Silverberg a ceci d'original
qu'elle nous présente une alternative en apparence intéressante à cette solution : plutôt que de réduire le nombre des naissances, réduisons
l'espace qu'occupent les hommes en construisant, non plus à l'horizontale, comme autrefois, mais à la verticale, de sorte que l'on puisse
à nouveau encourager le peuple à faire des enfants - beaucoup d'enfants - et qu'il devienne même un crime de s'y refuser. Cependant, loin
de se contenter d'évoquer un futur plus ou moins possible ou plausible, nous allons voir au cours des lignes qui suivent que Robert Silverberg nous
parle en réalité, comme tout auteur de science-fiction qui se respecte, du présent, c'est-à-dire de notre monde - bien réel, lui.
Pour commencer, le gigantisme des monades ne doit pas nous faire oublier que ce ne sont là bien évidemment rien d'autre
que d'immenses immeubles d'habitation, dans lesquels s'entassent, comme c'est d'ores et déjà
le cas aujourd'hui dans toutes les grandes villes du monde, une population citadine pullulante et sans cesse croissante, toutes les classes
sociales s'y retrouvant à la fois très proches les unes des autres et séparées par des cloisons qu'on dirait presque hermétiques en dépit de la
promiscuité qui règne en ces lieux - car on ne se reproduit jamais
qu'au sein d'une même caste. C'est pourquoi, si les habitants des monades sont encouragés à s'entre-défoncer, comme ils disent,
en tous sens et ce sans la moindre
entrave, il est cependant fort malvenu de changer de cité pour aller se payer une partie de jambes en l'air avec des personnes d'un niveau de vie
inférieur. En bas, les ouvriers, les petits fonctionnaires et les artistes. En haut les penseurs, les théoriciens, les dirigeants d'un monde
sans faille. On retrouve donc, en dépit des apparences, un système hiérarchique bel et bien semblable au nôtre, et ce d'autant plus qu'on ne le
pense et ne le décrit jamais comme tel - a priori, l'ascension sociale est possible, ou du moins le laisse-t-on croire. La verticalité des monades
nous rappelle ainsi la verticalité des rapports humains dont nous ressentons tous, de manière différente, les effets dans notre belle société.
Notre belle société de consommation, serait-il important de préciser ici. En effet, sourd et aveugle celui qui n'aurait pas remarqué,
depuis le temps, que les médias dans leur ensemble - publicitaires et cinéastes (beaucoup d'entre eux, tout du moins)
sont à mettre ici dans le même panier, si je puis dire - nous proposent et nous imposent à tous une vision particulière du monde qui,
somme toute et
tant bien que mal, nous relie les uns aux autres ou tente de le faire
par le biais de représentations communes qui font du consommateur le citoyen moyen idéal. Nous sommes donc, quoi qu'on en puisse dire, encore
dans un système religieux à certains égards, qui, plutôt que de prôner comme autrefois la chasteté, le respect des autres et l'amour
d'une entité supérieure à nous, fait littéralement la publicité d'un mode de vie peut-être plus libertin, plus individualiste, centré sur
l'amour de soi, le développement personnel et les notions de plaisir et de fun, y compris dans le travail,
mettant ainsi sur le même plan cette dernière activité sociale et les loisirs dont on use pour s'en divertir
- c'est-à-dire ce que l'on consomme grâce au fruit de notre dur labeur pendant notre temps "libre". Est-ce à dire que les deux s'équivalent ?
Que consommer reviendrait au même que travailler ? Nous n'en sommes pas très loin.
Sur ce point, notre monde n'est, encore une fois, pas si différent de celui des monades, dont le christianisme futuriste n'a plus grand-chose
de chrétien, si l'on excepte l'expression "Dieu soit loué !", répétée inlassablement, et l'importance accordée à la fertilité.
Paradoxalement, dans les deux sociétés - réelle et fictive -, cet individu que l'on célèbre
s'efface totalement face à la masse, en dépit de l'accent placé sur l'importance de chaque vie dans la monade et de la place centrale qu'accordent
aux particuliers (c'est le mot juste) les médias de notre monde, dans un système qui produit en série les biens comme les personnes (mot éloquent
s'il en est), les use, les recycle, les reproduit. C'est peut-être la raison pour laquelle les personnages des
Monades urbaines répètent si souvent trois fois les mêmes mots à la suite, comme si les mots eux-mêmes
pouvaient se reproduire. Mais également comme si l'écho des ces - incantations ? - se propageait dans le vide, inutile et pathétique. Ce qui
apparaît dès lors, c'est l'infinie solitude qui prédomine au sein de ces monotones monades. Malgré l'incitation constante au bonheur, on y est
souvent d'humeur morose et maussade. On s'y sent prisonnier. On voudrait, à l'instar de Micael Statler, l'analo-électronicien,
sortir pour voir enfin ce qui se trouve à l'extérieur, découvrir d'autres hozizons, franchir les façades transparentes
de ces immenses immeubles immobiles. Et lorsqu'on le fait, comme lui, qu'on
découvre les moeurs archaïques et cruelles des villages agricoles, on apprend à ses dépens, par comparaison, par contraste, grâce à la confrontation de ces
deux civilisations, de ces deux points de vue - l'un vertical, l'autre horizontal -, que toute cette vie
- celle des monades - n'était qu'une construction humaine, qu'une vision rendue plus ou moins concrète, un rêve auquel on désirait soumettre le monde réel par le truchement de
notre volonté, que toute cette vie, dis-je, n'était que fiction, qu'il en existe d'autres et que l'homme, une fois formaté, une fois habitué à un certain mode de vie, à certains standards,
autrement dit une fois standardisé - comme c'est également le cas des objets fabriqués en série -,
se trouve dans l'incapacité totale d'en changer, d'adopter et de
s'adapter à d'autres types de fonctionnement, d'autres systèmes, d'autres conceptions du monde, d'autres fictions. Incapable de quitter la monade, il y
retourne, comme Statler, s'y retrouve condamné à mort, balancé sauvagement dans la chute et, last but not least, recyclé tel un déchet.
Car ce qu'il sait désormais représente un danger pour lui-même et, par conséquent, pour la communauté. Dans La Petite fille qui aimait Tom Gordon, un autre grand nom
de l'imaginaire américain, j'ai nommé Stephen King, nous rappelle que l'homme moderne, l'homo consumens, livré à lui-même,
ne survivrait pas trois jours dans la nature. Sommes-nous donc si différents des personnages qui peuplent
Les Monades urbaines ?
En conclusion, Robert Silverberg, honnête dans sa démarche puisqu'il donne à sa réflexion la forme d'une fiction,
nous offre, avec ses Monades urbaines, une vision de monde - de notre monde - particulière, critique, presque
sociologique par certains aspects (les villages agricoles et le système urbmonadial reproduisant finalement les mêmes schémas, mais de deux manières différentes),
peut-être également quelque peu pessimiste, au centre de laquelle trône un être humain pris au piège de son instinct grégaire
et de son besoin de s'épanouir individuellement, prisonnier de ses propres constructions et contradictions, de ses propres désirs, de ses propres rêves - de ses propres
f(r)ictions.
Note : 9.5/10
Werna 2009-2023